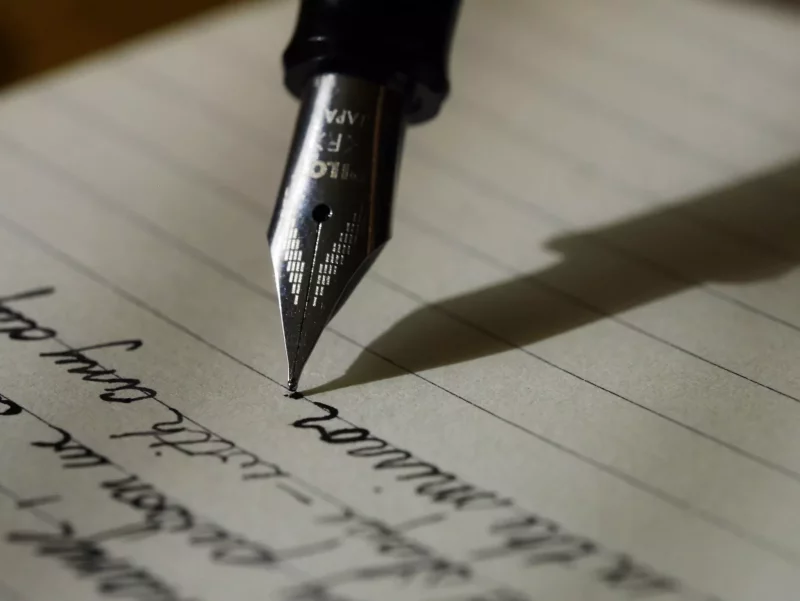La Cour de cassation vient de rendre une décision le 9 juin dernier en matière de successions, et plus spécifiquement sur la validité des testaments olographes, c’est à dire les testaments rédigés sans formalisme particulier, sur papier libre ou « sur un coin de table » comme on l’entend souvent.
L’article 970 du Code civil est limpide : « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Les faits :
Dans cette affaire, un homme de nationalité allemande, vivant en France depuis 1999, décède en 2003.
Son testament, olographe donc, est rédigé en français, signé et porte la date du 25 mars 2002.
Le même jour, un autre document a été établi en langue allemande pour traduire à cet homme le testament qu’il rédigeait alors en français.
Ce document retranscrit bien le testament mais n’a pas été rédigé par l’homme lui-même.
La procédure :
La Cour d’appel de Chambéry, saisie après une première décision d’un Tribunal de Grande Instance, juge que le testament est valable.
Mais la Cour de cassation casse cette décision en visant ce fameux article 970 du Code civil en indiquant :
« il est constant que le testateur avait rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté. »
L’analyse :
En se fondant sur l’article 970 du Code civil, la Cour de cassation justifie sa décision sur le terrain du formalisme : un écrit, daté, et signé de la main du testateur.
Or elle en déduit une règle qui s’apparente plus à une règle de fond : l’expression de la volonté au regard de l’usage de telle ou telle langue pour rédiger le testament.
Selon la Cour de cassation, le fait que testament était rédigé dans une langue que le testateur ne comprenait pas démontre que le testament ne peut être considéré comme l’expression de sa volonté.
Mais le document écrit en allemand, qui traduisait le testament écrit en français, permettait selon nous de déterminer si le testateur avait ou non conscience qu’il formulait ici l’expression de ses dernières volontés. La Cour de cassation ne s’attarde pas, curieusement, sur cette pièce qui paraissait pourtant décisive, ne retenant que la question de la langue utilisée pour rédiger le testament.
Nul doute que la doctrine, les juristes et les étudiants du pays consacreront du temps à analyser cette décision.
Responsabilité totale du garagiste qui procède à des réparations incomplètes du véhicule, même à la demande du client !
Il peut être tentant de limiter les coûts d'intervention sur un véhicule mais attention aux responsabilités si les réparations sont incomplètes... La Cour de cassation a fixé un cadre juridique limpide.
Lire la suite
Annulation du licenciement fondé sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée du salarié
C'est l'histoire d'une salariée qui a une relation sentimentale avec le Président de la société qui l'emploie, et qui est licenciée quand l'épouse du Président découvre la relation...
Lire la suite
Divorce pour faute : L'époux qui se marie religieusement avec son amante commet un adultère
Une décision originale a été rendue récemment par le Juge aux Affaires Familiales de Nanterre où l'époux, toujours marié civilement à son épouse, a décidé d'aller se marier religieusement avec sa nouvelle compagne...
Lire la suite
Excès de vitesse et cinémomètre : s’assurer de la vérification périodique (d’un an en principe)
Si les automobilistes sont soumis au Code de la Route, les appareils contrôlant les limitations de vitesse ont eux aussi leur réglementation.
Lire la suite
Que faire face à un permis de construire refusé à la suite d’un avis conforme défavorable de l’ABF ?
Que faire pour contester un refus de permis de construire fondé sur un avis conforme défavorable de l’ABF ? De nombreuses questions se posent : que faut-il contester ? Devant qui ? Dans quels délais ?
Lire la suite